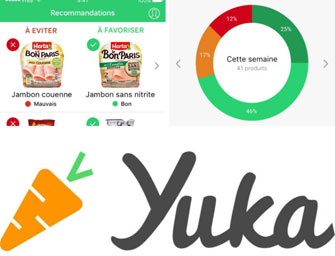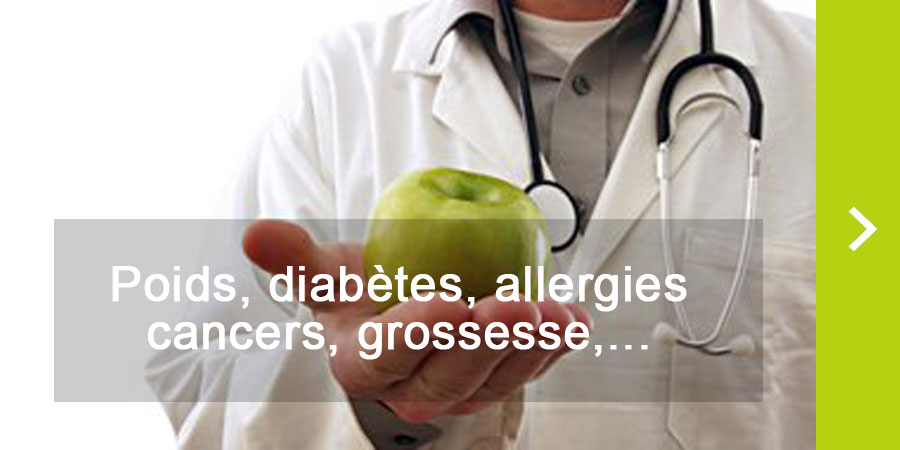L’essai clinique américain LOOK-AHEAD, mené entre 2001 et 2004 sur 5 145 sujets diabétiques de type 2 en surpoids ou obèses a montré qu’une perte de poids faisant suite à un régime hypocalorique pauvre en graisses ne réduisait pas l’incidence des maladies cardiovasculaires. Indice que la solution se trouverait plutôt dans l’amélioration de la qualité des graisses que dans la réduction de leur quantité.
C’est d’ailleurs à ce résultat que l’essai doit son interruption précoce. Mené sur deux groupes randomisés, l’un accompagné d’un suivi intensif, tant nutritionnel (par une réduction des apports) que sportif ; et l’autre, groupe témoin, étant accompagné d’un programme éducatif sur le diabète, l’essai devait durer 13,2 ans. L’objectif pour le premier groupe était d’observer au moins 7 % de perte de poids. Mais au bout de 9,6 ans de suivi, aucune différence sur l’incidence des maladies cardiovasculaires n’est apparue entre les deux groupes, alors même que les différences en termes de perte de poids étaient significatives : - 6 % pour le groupe à suivi intensif contre - 3,5 % pour le groupe témoin.
Un résultat surprenant donc, qui s’expliquerait par la qualité des graisses consommées, si on en croit les résultats de l’étude PREDIMED qui montrait début 2013 la supériorité du régime méditerranéen sur le régime hypolipidique en termes de prévention des maladies cardiovasculaires, en particulier chez les sujets diabétiques. Autre hypothèse avancée, la possibilité que les patients déjà sous traitements (statines et antihypertenseurs) ne laissent apparaître un bénéfice nutritionnel qu’après plusieurs décennies.
Pour aller plus loin :
-
Boissons énergisantes : face aux risques avérés, une réglementation s’impose
-
Boissons énergisantes: l'ANSES identifie les risques associés aux boissons énergisantes
-
L’ostéoporose, un mal qui frappe au cœur des os
-
Remplacer le soda par du lait, du café ou du thé diminuerait le risque d’accident vasculaire cérébral
-
Le fromage jouerait un rôle important dans le fameux french paradox
-
Avis scientifique sur l'apport maximal tolérable en vitamine D